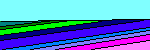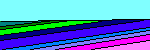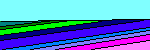
Excursion "Rias pliocènes du var et de ligurie : comblement sédimentaire et évolution géodynamique" organisée par
Georges Clauzon, Jean Loup Rubino, Jean Pierre Suc : 6, 7 et 8 septembre 1996
Le Groupe Français de Géomorphologie (GFG) et le Groupe Français d'étude du Néogène (GFEN) ont organisé les 6, 7 et 8 septembre 1996, une excursion intitulée "Rias pliocènes du Var et de Ligurie : comblement sédimentaire et évolution géodynamique", cette excursion a été menée par Georges Clauzon, Jean Loup Rubino et Jean Pierre Suc.
La connaissance du Pliocène méditerranéen s'est considérablement enrichie au cours des vingt dernières années. Pour bien mesurer cette évolution il faut revenir à ce qui a été l'acquis pour de nombreuses générations de géologues et de géomorphologues.
La position classique a été définie par M. Gignoux (1926), et H. Baulig (1928) p 477 : "Le Pliocène correspond à un cycle sédimentaire, à une série de remblaiement suivie d'une période de creusement qui inaugure le Quaternaire… Au-dessus d'un conglomérat de base ordinairement mince, viennent de puissantes marnes bleues à faciès profond ; puis, le remblaiement venu de la terre progressant, les sédiments deviennent plus grossiers : on a des sables jaunes à faune plus littorale ; enfin, arrivent les plaines côtières, de sorte que la série se termine par des conglomérats, marins d'abord, puis purement continentaux. Pour ces faciès, qui se retrouvent toujours dans le même ordre dans beaucoup de régions, on a créé trois noms d'étages : les marnes bleues forment le Plaisancien ; les sables jaunes, l'Astien ; les conglomérats continentaux, le Villafranchien". Ce remblaiement s'est effectué à la périphérie de la zone méditerranéenne et à l'intérieur de nombreuses vallées côtières les transformant en de véritables "rias pliocènes" elles aussi reconnues et cartographiées depuis plus d'un siècle tout autour de la Méditerranée. Ces vallées auraient été creusées par érosion régressive au cours d'un abaissement exceptionnel du niveau de la mer (1000 à 2000 m), abaissement local dû à la fermeture momentanée du seuil de Gibraltar. Ce consensus a perduré jusqu'au début des années soixante dix, mais avec le développement des études fines un nombre croissant de difficultés sont apparues parmi lesquelles on peut citer : le long du littoral provençal et languedocien, suivant les sites (et les auteurs) les sables Astiens étaient considérés soit comme un étage soit comme un faciès littoral "oxydé" des marnes bleues, la présence ou l'absence de galets était notée par les auteurs à l'intérieur des même marnes (cf. Baulig) ; les sables du site éponyme de Villafranca d'Asti n'étaient pas astiens, des sables jaunes, marins à faune continentale cohabitaient avec des sables continentaux villafranchiens etc. Une nouvelle synthèse était nécessaire.
Le renouveau est apparu avec la mise en évidence : 1) des accumulations salines "évaporites messiniennes" découvertes dans les sondages ODP, 2) par une datation précise des marnes bleues et 3) par une conception nouvelle du remplissage des paléovallées. Ces trois points sont indissociables, mais seul le troisième a été bien développé lors de l'excursion. La reconstitution proposée par G. Clauzon (cf. Géomorphologie 1996, N°1 pp. 3-26) est d'associer dans la même isochrone, la topographie continentale, la zone littorale de ce qu'il propose d'appeler un "Gilbert delta" et la zone de sédimentation profonde. Cette position éminemment géomorphologique est appuyée par ses collègues sédimentologues et stratigraphes.
Le bassin Pliocène du Var s'étend sur 30-40 km de long, cette série est emboîtée dans le substratum méso-cénozoique. La surface "d'érosion messinienne" est la surface basale enveloppante qui contient le remblaiement (Gilbert delta). Le prisme sous aquatique de ce delta est formé de fore sets conglomératiques ; il s'agit (nécropole de Nice) sur 150 m d'épaisseur d'un empilement régulier de couches décimétriques inclinées de 15 à 20°, latéralement ces passées ont fourni une faune permettant de placer ce front deltaïque dans la biozone MPl2 (à la base du Pliocène vers 5 Ma). La vallée actuelle du Var ne suit pas toujours la vallée messinienne notamment en amont de St Martin où le fleuve actuel a un canyon indépendant de la ria Pliocène. La carrière d'argile de St Martin du Var a fourni une faune de la base du Pliocène (biozone MPl1), la paléobathymétrie indique une profondeur de 300-500 m, ces marnes sont les bottom sets du delta, ils passent aux fore sets conglomératiques qui ici aussi sont très épais. Le Var - comme l'ont aussi fait l'Orb, la Durance, le Tech …- va combler cette ria d'abord avec des sédiments sous aquatiques puis par ses conglomérats, ce double remblaiement permettra de fossiliser une topographie marine et continentale. Toute translation latérale sur ce cône, associée aux variations eustatiques quaternaires va permettre aux fleuves côtiers de tailler des vallées épigéniques dans des roches variées, laissant parfois des tronçons de vallées mortes (cas de la Vésubie à Levens, du Var au Signal de Huesti, de la Tinée …) cette procédure est appelée "épigénie d'aggradation". Elle existe aussi en Ligurie dans la région d'Albenga ou l'on a le même schéma général, creusement messinien, remplissage par les deltas, épigénie d'aggradation. La carrière de Garlanda est particulièrement impressionnante puisqu'elle montre un niveau de condensation à galets rubéfiés, perforés et glauconitisés recouverts par le remplissage pliocène ou alternent marnes bleues et conglomérats. Manifestement le schéma proposé par G. Clauzon et ses collègues depuis une vingtaine d'années ne fait que s'enrichir de nouvelles observations et la démonstration prend la force d'un nouveau paradigme car la séquence messinien - pliocène n'est pas seulement un phénomène sédimentaire (exceptionnel), c'est un cadre dans lequel la tectonique est elle aussi reconstituée jusqu'à 50 km dans l'arrière pays niçois et 1200 m d'altitude.
A la fin de cette excursion, deux résultats sautent aux yeux du géomorphologue : l'importance de la tectonique et l'importance de l'érosion messinienne. En particulier l'arc de Castellane est installé à la fin du Miocène avant la crise de salinité, au contraire l'arc de Nice se met en place au Pliocène supérieur et au Quaternaire, ces deux ensembles ont en outre subi une surrection verticale, leur vitesse serait de l'ordre de 1000 m en 2Ma. En Ligurie, les mouvements sont uniquement verticaux et de l'ordre de 500 m. Inversement l'entaille messinienne est de plusieurs centaines de m à l'aval et remonte de plusieurs dizaines de km jusqu'au pied du Mercantour, l'épigénie quaternaire du Var est elle aussi de l'ordre de 1000 m. Grâce à la présentation de G. Clauzon on s'aperçoit que le volume montagneux de cette région est excessivement jeune.
De ce beau travail on peut tirer des leçons importantes : la période des datations relatives est terminée. Pour progresser il nous faut des datations absolues, que celles ci proviennent de la faune, des pollens, du paléo magnétisme ou des isotopes, peu importe, il faut absolument dater. Les reconstitutions paléogéographiques doivent être globales, aller du continent au rivage et du rivage aux fonds marins. La position du niveau de base général a trop longtemps aveuglé les géomorphologues, il faut apprendre à s'en passer. La connaissance des processus s'améliorera dès lors que des vitesses des mécanismes pourront être mesurées.
jlm in Géomorphologie 1997 N°2 pp 187-188